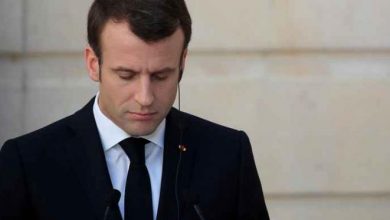« L’afropolitanisme et le cosmopolitisme enraciné, deux manières de penser l’Afrique »

LE RENDEZ-VOUS DES IDÉES. Face à la montée de la question identitaire, l’universitaire congolais Kasereka Kavwahirehi analyse les concepts portés par Achille Mbembe et Kwame Anthony Appiah.
Tribune. Afroféminisme, afropolitanisme, patriotisme cosmopolite (cosmopolitan patriotism) ou cosmopolitisme enraciné (rooted cosmopolitanism). Depuis quelques années, ces notions nourrissent verses et controverses parmi les chercheurs, écrivains, artistes et militants africains et afrodescendants. Si certains se déclarent volontiers afropolitains ou afroféministes, d’autres refusent ces qualificatifs jugés trop spécifiques et préfèrent se présenter comme féministes africaines ou « féministes et noires ». Ces positionnements soulèvent quelques interrogations.
Que révèlent ces notions quant au rapport à l’Afrique à laquelle elles se réfèrent toutes ? Quel changement apportent-elles, si changement il y a, dans la manière dont les Africains se situent et rendent compte de leur expérience dans le monde d’aujourd’hui ? La question de l’origine et de l’identité se pose-t-elle de la même manière dans le cadre des deux nouveaux concepts dominant le paysage intellectuel africain et afrodiasporique, à savoir le cosmopolitisme enraciné du Ghanéen Kwame Anthony Appiah et l’afropolitanisme du Camerounais Achille Mbembe ?
De la Grèce antique aux Etats-Unis
La notion de cosmopolitisme n’est pas récente. On la doit au philosophe cynique Diogène de Sinope, qui l’a élaborée au IVe siècle dans la Grèce antique. Le terme est dérivé du grec cosmos, qui signifie l’univers, et de politês, le citoyen. Propagé dans le monde antique par les philosophes stoïciens, parmi lesquels on peut citer Zénon de Kition, il a été redécouvert durant la Renaissance, avant que les philosophes des Lumières se l’approprient. Ses partisans partaient du postulat que notre existence politique et morale devrait se jouer sur une scène mondiale et que chacun de nous appartenait à une communauté d’êtres humains qui transcende les particularités de l’affiliation locale. Etaient donc mis de côté les attachements locaux.
Mais à partir des années 1990, une nouvelle école de pensée affirme que la perspective cosmopolite exige et implique les racines mêmes qu’elle prétend transcender. De là, la notion de cosmopolitisme enraciné, employée pour la première fois aux Etats-Unis en 1992 par Mitchell Cohen, avant d’être popularisée par le philosophe ghanéen Kwame Anthony Appiah au milieu des années 1990. Le cosmopolitisme enraciné a ensuite été adopté par divers théoriciens et philosophes politiques nord-américains comme Sidney Tarrow, Bruce Ackerman et Will Kymlicka.
D’entrée de jeu, le concept de cosmopolitisme enraciné paraît oxymorique. Avoir des racines, c’est être ancré dans une histoire, une nation ou un peuple spécifique, alors qu’être cosmopolite, c’est se déclarer citoyen du monde. Deux options contradictoires qu’Appiah réconcilie à travers l’exemple de son père, Joe Appiah, qui, tout en étant un nationaliste ghanéen et africain, avait une foi inébranlable dans l’internationalisme.
Manière de penser et de vivre la diversité, le cosmopolitisme enraciné célèbre le fait qu’il y a différentes manières locales d’être humain. Le cosmopolite peut être patriote, aimer profondément sa patrie – pas seulement l’Etat où il est né, mais l’Etat où il a grandi et l’Etat où il vit –, tout en cultivant sa loyauté envers le genre humain. Il peut envisager un monde où chacun est un cosmopolite enraciné, attaché à sa patrie, avec ses propres particularités culturelles, et prendre plaisir à la présence de lieux différents, qui sont des patries d’autres personnes différentes.
Mais contrairement au nationalisme, le cosmopolitisme et le patriotisme sont des sentiments plus que des idéologies. C’est la connexion et l’affection qui comptent. Le cosmopolite peut s’éloigner physiquement et cognitivement de son lieu d’origine, il n’en reste pas moins attaché à ce lieu et aux réseaux sociaux le traversant, sans perdre accès aux ressources, expérience et possibilités qu’il lui offre.
« Une certaine poétique du monde »
La notion d’afropolitanisme naît en 2005, selon le chercheur Patrick Awondo, qui constate deux foyers d’émergence simultanés. L’Europe, sous la plume de l’écrivaine d’origine ghanéenne Taiye Selasi, née à Londres et installée à Rome. L’Afrique, avec le philosophe camerounais Achille Mbembe, basé à Johannesburg. Taiye Selasi, qui popularise le concept dans son essai Bye-Bye Babar,le définit comme une forme de présence africaine dans le monde et fait des capitales du G8 les points géographiques à partir desquels les afropolitains marquent le monde de leur présence. Là où Achille Mbembe fait partir la trajectoire afropolitaine de l’Afrique, dont la fluidité et la circulation des mondes sont constitutives depuis le XVe siècle.
Selon lui, l’afropolitanisme se définit comme une « sensibilité culturelle, historique et esthétique », « une stylistique et une politique, une esthétique et une certaine poétique du monde ». Il s’inscrit, sans s’y réduire mais pour passer à autre chose, dans l’histoire du discours africain depuis le nationalisme anticolonial, la négritude et le panafricanisme, jusqu’aux œuvres de Fabien Eboussi Boulaga et Valentin-Yves Mudimbe, en passant par Cheikh Anta Diop. Ce qui le distingue du cosmopolitisme de Kwame Anthony Appiah, qu’on peut rattacher à la philosophie libérale de John Stuart Mill et, bien sûr, à l’internationalisme de son père.
Même si l’afropolitanisme se nourrit de la philosophie d’Eboussi Boulaga, qui, en 1977, écrivait déjà que « les problèmes de la particularité sont déterminés par l’avènement d’une histoire une, d’une histoire mondiale », et de l’œuvre de Mudimbe, qui vise une décolonisation de la représentation de l’Afrique et des Africains, il serait erroné de dire que l’afropolitanisme se situe dans la continuité de la négritude, du nationalisme et du panafricanisme. Au contraire ! Il signe plutôt un dépassement de ces derniers en raison de leur incapacité à rendre compte de la manière d’être des Nègres, leur façon d’habiter le monde sous le signe de ce que Mbembe appelle l’imbrication des mondes et la domestication des signes qu’ils n’ont pas librement choisis pour les mettre à leur service. L’afropolitanisme se distingue précisément de la négritude et du panafricanisme en ce que son point de départ n’est pas la différence mais l’appartenance foncière de l’Afrique au monde, le commun, la similitude, c’est-à-dire « ce qui fait des Nègres des hommes et des femmes comme les autres ».
L’afropolitanisme traduit aussi l’éveil de l’Afrique contemporaine aux figures du multiple, constitutives de ses histoires particulières, la « conscience de l’imbrication de l’ici et de l’ailleurs, la présence de l’ailleurs dans l’ici et vice-versa », selon Mbembe, de la circulation des mondes, de la dispersion des populations et de la mobilité des cultures depuis des siècles sur le continent. Ceci entraîne la relativisation des origines et des appartenances primaires ainsi que la disposition d’embrasser l’étranger et le lointain, de valoriser les traces du lointain dans le proche, etc. Il ne faut donc pas avoir visité des contrées lointaines pour être afropolitain.
Une identité ethnique ouverte à l’autre
Il y a bien une résonance entre le cosmopolitisme enraciné et l’afropolitanisme, même s’il s’agit bien de deux manières différentes de penser l’Afrique et le monde, la diversité culturelle, la similitude et la circulation. En inscrivant l’afropolitanisme dans l’histoire du continent depuis le XVesiècle, Mbembe signifie que l’Afrique repliée sur elle-même et n’ayant rien apporté au monde est une pure et simple invention sans fondement. De la même manière, l’idée d’une Afrique pure de tout apport extérieur est un de ces mensonges qui nous lient, pour parodier le titre du dernier livre d’Appiah, The Lies That Bind.
Le continent a toujours été acteur à part entière du devenir monde. En montrant que la fluidité et la circulation sont constitutives de l’Afrique depuis des siècles anciens d’une part et, d’autre part, que l’ancrage dans une histoire singulière ne s’oppose pas à l’ouverture aux autres humains et à leurs pratiques et croyances, Mbembe et Appiah montrent, chacun à sa manière, l’irrationalité des discours de la clôture identitaire. Pis, la circulation et la fluidité suggèrent les limites de l’idée d’une identité ethnique fixe et fermée. Autrement dit, l’ethnie n’est pas niée mais s’ouvre au monde, à l’autre qui est mon semblable. Elle est à penser et à vivre comme un site dynamique, un segment du monde, une partie totale.
Enfin, l’origine est relativisée chez nos deux penseurs. Leurs écrits peuvent faire écho aux mots du philosophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga, décédé en octobre 2018 : « Le Muntu [c’est-à-dire l’homme ou la femme dans la condition africaine] n’a pas à renoncer à soi pour rejoindre les autres. Il lui suffit de s’approfondir, de se considérer comme un segment du monde, une partie totale. Il y a réciprocité entre l’univers du Muntu et le monde, enveloppement mutuel. L’un médiatise l’autre. »
Kasereka Kavwahirehi
Cet article est paru d’abord dans le journal Le Monde
Source: Le Pays